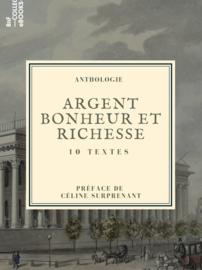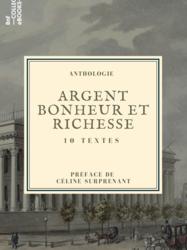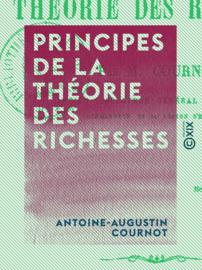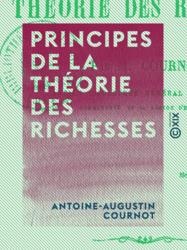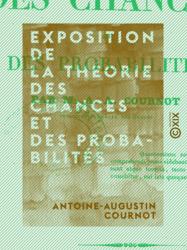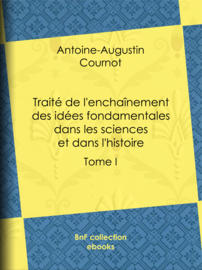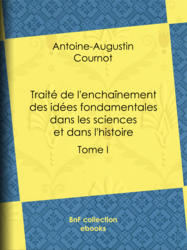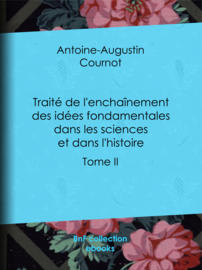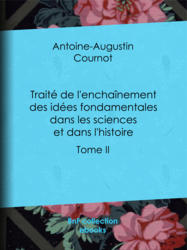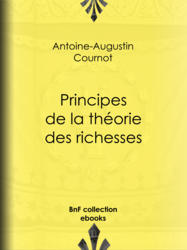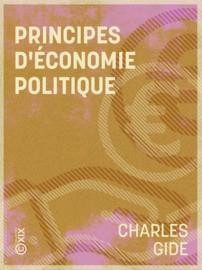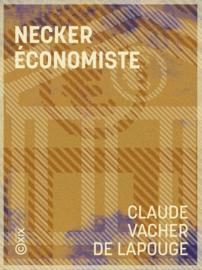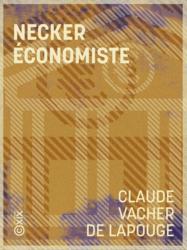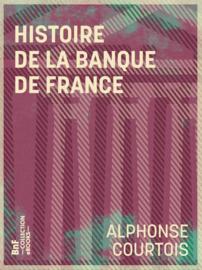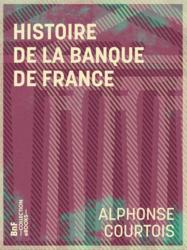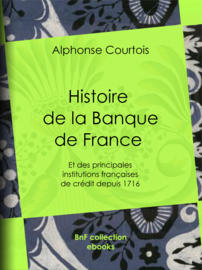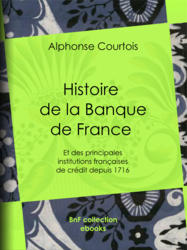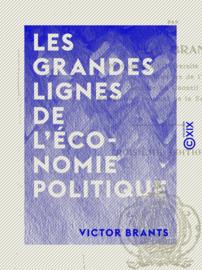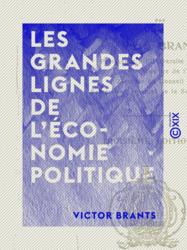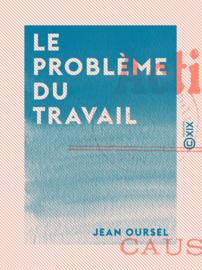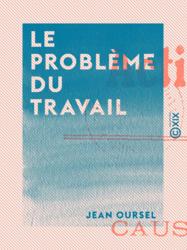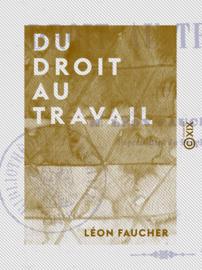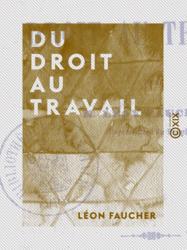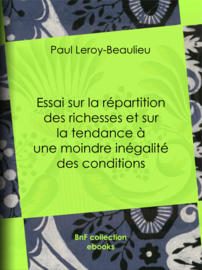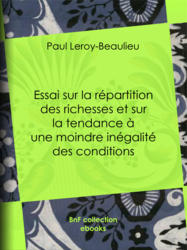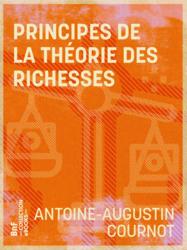
Principes de la théorie des richesses
Descriptif : Tout ce qui se rapporte à la richesse est trop souvent considéré par les politiques comme une affaire d’opinion. Appliquer les mathématiques sert à distinguer ce qui se prête aux “solutions vraiment scientifiques” des “idées vagues” qui s’y refusent (utilité, rareté, force, etc.). Cournot (1801-1877) reprend dans les Principes des idées élaborées dans les Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, publiées en 1838. Il montre, sans “l’algèbre” du premier livre, que la richesse se prête à un traitement précis, même si elle découle du “jeu des forces et des fonctions de la vie, dans toutes les parties du corps social”. Cournot s’interroge ici sur la place de l’économie parmi les sciences, car les richesses (traduction de ce qu’Aristote appelait chrématistique), sujet prégnant sous le Second Empire, appellent aussi une théorie d’économie “sociale” (distincte de l’économie “politique”).